Le roman policier, si répandu et si populaire aujourd’hui, est un genre pourtant relativement récent, qui a émergé au 19e siècle, quand ont été réunies des conditions sociales et littéraires favorables.
Le contexte social
Avec la révolution industrielle, la population des grandes villes augmente considérablement au 19e siècle (ainsi, celle de Paris double dans la 1re moitié du siècle, passant d’environ 550 000 habitants en 1801 à plus d’un million en 1851), et cet essor s’accompagne du développement de l’insécurité et de la criminalité.
La police connaît à la même époque une évolution : l’institution mise en place par Joseph Fouché sous le Consulat et l’Empire est avant tout une police politique, qui surveille les opposants au régime et utilise des méthodes pas toujours très honorables (recours à des informateurs ou même à des criminels employés comme auxiliaires de police). Au cours du siècle, une autre forme de police émerge graduellement, qui enquête sur les délits et crimes non politiques et s’appuie sur des méthodes scientifiques — alors que jusque-là, c’étaient essentiellement les témoignages et les aveux (parfois obtenus par la torture) qui permettaient de condamner les coupables. De nouvelles méthodes sont élaborées : observation des scènes de crime, collecte d’indices, et plus tard photographie des cadavres. La médecine légale se met en place, avec la pratique des autopsies, et le développement de la toxicologie qui permet de détecter les poisons. L’identification des criminels, qui se limitait alors à des fiches comportant un vague signalement des délinquants et au marquage des forçats à perpétuité, est prise en charge par un service de l’identité judiciaire, qui utilise un fichage à partir de mesures corporelles et de photographies (pour le système d’anthropométrie judiciaire créé par Alphonse Bertillon dans les années 1880), puis (après 1900) à partir d’empreintes digitales.
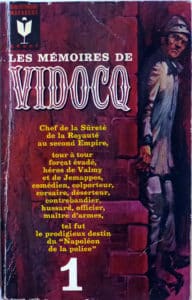
L’intérêt du public pour le fait divers criminel se développe, dès 1800, avec le procès de la bande criminelle des Chauffeurs d’Orgères, qui sévissait dans la Beauce. Une succession d’affaires transforment des criminels en « vedettes » lors de procès très médiatisés : l’affaire Fualdès (1817-18), l’auberge rouge de Peyrebeille (1833), le procès de Pierre-François Lacenaire (1835-36), l’affaire Lafarge (1840), Jean-Baptiste Troppmann « le massacreur de Pantin » (1869-70), etc.
Cet intérêt se développe essentiellement par le biais de la presse, qui est en plein essor :
- La presse quotidienne prend de l’importance : le 1er juillet 1836 apparaissent La Presse d’Émile de Girardin et Le Siècle d’Armand Dutacq, puis (le 1er février 1863) Le Petit Journal de Moïse Millaud qui, en 1865, a un tirage de 259 000 exemplaires et se vend 5 centimes. Ces journaux s’appuient sur le sensationnel, insistent sur l’insécurité, les faits divers spectaculaires et les affaires criminelles ; ils publient des « causes judiciaires » (souvent relatées par des journalistes qui écriront plus tard des romans policiers) ; ainsi que des romans-feuilletons, souvent inspirés de crimes réels.

- Les Canards, feuilles d’information reprenant un événement sensationnel relaté par les quotidiens, en le développant et l’illustrant par des gravures, font la part belle aux faits divers criminels (par exemple : « Un crime sans précédent !!! Une femme brûlée vive par ses enfants. Détails horribles »).
Le contexte littéraire
Les romans publiés à cette époque de changements reflètent les nouvelles préoccupations de la société. On trouve ainsi :
- Des romans-feuilletons criminels qui dévoilent les bas-fonds des grandes villes : le succès des Mystères de Paris (1842-43) d’Eugène Sue inspire de nombreux romanciers à écrire des mystères situés dans d’autres villes européennes, en premier lieu Londres (avec dès 1843-44 Les mystères de Londres, signé Sir Francis Trolopp, alias Paul Féval) puis Lisbonne, Naples, Florence, Berlin, Constantinople, etc.
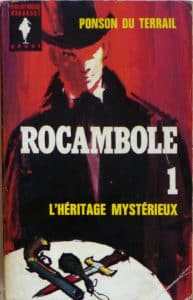
- Des romans s’intéressant à la psychologie des criminels : L’assassinat du Pont-Rouge (1855) de Charles Barbara, dans lequel le personnage principal commet un meurtre prémédité, puis évolue du cynisme au remords ;
- Des romans d’erreur judiciaire ou romans de la victime : Eulalie Pontois (1840) de Frédéric Soulié, dans lequel une jeune femme est accusée à tort de l’assassinat d’une vieille dame, mais se tait pour protéger le meurtrier qu’elle a vu tuer la vieille dame et s’emparer de son testament.
Enfin, le roman populaire des années 1820-1850 fait une grande place au mystère (peut-être sous l’influence du roman gothique anglais de la fin du 18e siècle), ayant son origine dans une histoire antérieure qu’il s’agit de mettre à jour, mais dont la révélation est retardée. Par exemple, le héros des Mystères de Paris, Rodolphe, semble être un ouvrier jouant le rôle de justicier dans les bas-fonds de Paris, alors qu’il est en réalité un aristocrate à la recherche de sa fille née hors mariage.
Émergence du genre policier
Parmi tous les textes parus au 19e siècle, lors des balbutiements du genre policier, et dont nous n’avons encore qu’une connaissance partielle (puisqu’il n’existait alors aucune collection spécialisée, et que ces textes paraissaient essentiellement dans la presse, qui est encore loin d’avoir été entièrement explorée), nous retiendrons quelques jalons qui constituent des étapes importantes vers le roman policier tel qu’il a été codifié au 20e siècle :
- L’espion de police (roman de mœurs) (1826) d’Étienne de Lamothe-Langon met au premier plan un policier professionnel, chargé de confondre un sous-officier soupçonné de conspirer contre le pouvoir. Ce personnage, qui selon l’auteur exerce « la profession la plus infâme », illustre la police à l’ancienne mode, occupée à traquer les opposants au pouvoir de Louis XVIII, et utilisant pour cela des indicateurs, la filature et le chantage. Il nous promène également dans les bas-fonds de Paris, ainsi qu’à la morgue.
- Le nouvelliste Marie Aycard est l’auteur de plus d’une dizaine de nouvelles criminelles parues dans les années 1840, par exemple « La fouine » (1841), dans laquelle un gentilhomme champenois qui se rend à Paris en chaise de poste est détroussé la nuit aux abords de la capitale et son domestique assassiné, illustrant ainsi l’insécurité régnant aux abords de Paris.
- Jean Diable (1862) est un autre roman de Paul Féval, dans lequel un policier de Scotland-Yard, Gregory Temple, affronte le redoutable criminel Jean Diable le Quaker. Gregory Temple est un ancêtre des détectives raisonneurs : il représente « le miroir le plus parfait du détectif sans peur et sans reproche » (Détectif est une tentative de francisation du terme anglais detective, apparu en anglais en 1850, dans le sens « inspecteur, agent de police secrète » ; la forme détective, empruntée à l’anglais et adaptée au français, n’apparaît qu’en 1871 pour désigner un policier officiel chargé de mener des enquêtes, et plus tard un policier privé qui mène des enquêtes), qui effectue de « savants calculs déductionnistes ». Il est l’auteur d’un manuel intitulé L’Art de découvrir les coupables, méthode logique d’analyse des crimes, ancêtre de notre police scientifique actuelle !
- À l’étranger aussi sont publiés de nombreux textes précurseurs du genre : au Danemark par exemple, dès 1829, avec Le vicaire de Vejlby de Steen Steensen Blicher, qui détaille une enquête sur un meurtre et le procès qui s’ensuit, aboutissant à une erreur judiciaire ; aux États-Unis d’Amérique, avec la série Diary of a Philadelphia lawyer (1838) de William E. Burton, dont fait partie « The Cork Leg » (mars 1838), dans laquelle un agent de la police de Paris doit démasquer un coupable parmi trois suspects, à l’aide d’un indice (il porte une jambe de bois). Sans oublier, bien sûr, les trois célèbres nouvelles d’Edgar Poe : « Double assassinat dans la rue Morgue » (1841), « Le mystère de Marie Roget » (1842), « La lettre volée » (1844), dans lesquelles un enquêteur amateur, le Français C. Auguste Dupin, résout des énigmes criminelles. Ces nouvelles sont conçues comme l’illustration des capacités de réflexion, de « ratiocination » ; elles s’intéressent principalement au raisonnement logique, et pas aux victimes, ni au criminel, ni même au déroulement d’une enquête policière. Ces trois contes peuvent être vus comme le modèle du « récit-problème » ou récit d’énigme.
Dans les deux premiers tiers du 19e siècle, le roman populaire s’est donc déjà intéressé :

- aux victimes et faux coupables avec le « roman de la victime » (Eulalie Pontois de Frédéric Soulié) ;
- aux enquêteurs (L’espion de police de Lamothe-Langon ; M. Jackal, chef de la police dans Les Mohicans de Paris d’Alexandre Dumas, 1854-55), dont certains, à l’image de C. Auguste Dupin, ont du génie (Gregory Temple dans Jean Diable de Paul Féval).
Le triangle fondamental du roman policier (criminel/victime/enquêteur, auxquels on peut ajouter le suspect et le faux coupable) existait donc déjà. Pour autant, il n’y pas encore de roman policier proprement dit. Pour que ce nouveau genre fictionnel voit le jour, il faut peu de choses : une nouvelle organisation narrative des éléments mis en place précédemment. Cette petite révolution a lieu au milieu des années 1860.
Le “roman judiciaire”
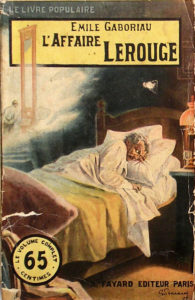
Gaboriau associe le roman de mœurs (qui décrit un milieu social ou un problème de société) et l’enquête policière au sein d’une même œuvre, dans une organisation narrative particulière (déjà employée dans les nouvelles d’Edgar Poe) : l’histoire débute par la découverte du cadavre de la veuve Lerouge, c’est-à-dire par la conclusion d’un ensemble de liens et d’événements liant divers personnages (traités habituellement par le roman de mœurs), qui amènent l’un d’entre eux au meurtre. L’enquête policière qui démarre le récit vise non seulement à identifier le coupable et les circonstances du meurtre (comme c’est le cas chez Poe), mais aussi à déterminer ses causes, c’est-à-dire à reconstituer les événements et les relations ayant abouti à ce drame. Il y a donc deux récits qui se succèdent, mais dont la chronologique est ici inversée, le second (l’enquête policière) devant mettre progressivement à jour ce qui s’est passé avant (dans le roman de mœurs). C’est cette structure régressive qui définit le genre du roman policier.
Dans ce premier roman judiciaire (d’après l’appellation de l’éditeur Dentu) de Gaboriau, la greffe entre roman de mœurs et récit policier est nettement visible : L’affaire Lerouge débute par l’enquête menée par un enquêteur amateur (le père Tabaret, dit Tirauclair), qui s’interrompt et cède la place au roman de mœurs, qui traite d’enfant illégitime, d’héritage et de substitution d’enfants ; le récit revient ensuite à l’enquête avec l’arrestation du coupable et la conclusion de l’affaire. Dans cette première forme de roman policier, il est fréquent que le récit de la genèse du crime ait une place très importante et soit enchâssé, de manière indépendante, dans le récit de l’enquête, donnant l’impression de deux histoires indépendantes.
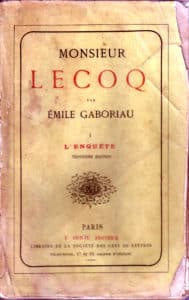
Monsieur Lecoq prend sa retraite à Orcival en 1868. Mais Gaboriau écrit encore un dernier roman policier, Le petit vieux des Batignolles (1870), qui se rapproche beaucoup de la forme classique du roman d’énigme : plus court que les romans précédents, il intègre davantage les deux histoires en dévoilant peu à peu, au cours de l’enquête, le récit du crime et de ses causes, souvent sous forme d’hypothèses.
Le succès des romans judiciaires de Gaboriau, tant en France qu’à l’étranger, incite de nombreux auteurs à se lancer dans cette voie. Nous nous contenterons de signaler quelques auteurs et quelques œuvres :
- Fortuné du Boisgobey apporte plusieurs contributions au genre, dès 1869 avec Disparu ! Puis Le coup de pouce (1874) ; Le crime de l’Opéra (1879) ; La main coupée (1880) ; Le crime de l’omnibus (1881) ; Le coup d’œil de M. Piédouche (1883). Et il reprend même, en 1877, le personnage de M. Lecoq dans La vieillesse de Monsieur Lecoq.
- Maximilien Heller (1871) de Henry Cauvain, est un roman qui donne une impression de déjà-vu… par anticipation ! En

- Madame Sept-Quatre (1873) et La poire d’angoisse (1874-75) de Jules Lermina, qui dès 1870 avait créé sur le modèle de Dupin un personnage de détective amateur, Maurice Parent, « un devineur de rébus qui ne fait pas trop mauvaise figure auprès de Dupin et qui a attaché son nom à des affaires qui valent presque « La lettre volée » ou « Double assassinat de la rue Morgue » ».
- La chambre du crime (1874), une énigme en chambre close ; Le roi des limiers (1879) d’Eugène Chavette, dans un registre humoristique.
- L’assassin du percepteur (1877) et Le crime de Pierrefitte (1879) d’Elie Berthet, qui dès 1853 a fait figurer un meurtre en chambre close dans son roman Le mûrier blanc.
- Les Mémoires d’un détective de René de Pont-Jest, est le titre général sous lequel sont parus 3 romans : Le numéro 13 de la rue Marlot (1876) ; La femme de cire (1877) ; Le cas du docteur Plemen (1887), qui mettent en scène le détective américain William Dow, un médecin devenu auxiliaire bénévole de la police, qui intervient lorsque des coupables risquent d’échapper à la justice ou pour éviter à des innocents d’être victimes d’erreurs judiciaires, en utilisant ses connaissances en médecine légale et la pratique de la contre-autopsie. Ces romans contiennent de nombreux détails de procédure policière (déroulement d’une enquête de police, conditions de détention des accusés), et des scènes de procès qui rappellent que René de Pont-Jest a été chroniqueur judiciaire pour divers journaux.
- L’inconnu de Belleville (1881) et Le crime de la rue Monge (1890) de Pierre Zaccone, qui est également l’auteur d’une Histoire des bagnes depuis leur création jusqu’à nos jours.
Arrêtons-là notre catalogue, qui pourrait encore contenir de nombreux titres. Jusqu’à la fin du siècle, aucun auteur ne se spécialise dans le roman policier, et il n’existe pas encore de collection spécialisée. Le genre reste encore fortement lié au roman populaire : roman de mœurs, roman gothique et criminel, roman d’aventures (l’enquête cédant souvent la place à la poursuite du coupable démasqué). Ceci témoigne de la constitution du genre, en tant qu’association entre thèmes du roman populaire et technique du récit policier.
Un nouvel enquêteur venu d’outre-Manche
Émile Gaboriau, Fortuné du Boisgobey, Jules Lermina, Pierre Zaccone… : autant de noms méconnus (voire complètement ignorés !) de la plupart des lecteurs de romans policiers au 21e siècle ! Leurs enquêteurs ont sombré dans l’oubli au profit d’un détective privé anglais, apparu en novembre 1887 et devenu mondialement célèbre : Sherlock Holmes.
Et pourtant, ceux qui connaissent Sherlock Holmes connaissent, sans le savoir, ses prédécesseurs !
Dans son autobiographie parue en 1924 (traduite sous le titre Ma vie aventureuse, Albin Michel, 1932), Arthur Conan Doyle a reconnu l’influence de Poe et de Gaboriau dans la création de son personnage. Et dès sa première apparition, Holmes cite ses illustres prédécesseurs, en les prenant d’assez haut : « à mon avis, Dupin était un type tout à fait inférieur ! (…) Il avait incontestablement du génie pour l’analyse ; mais il n’était certes pas le phénomène auquel Poe semble croire ! » Quant à Monsieur Lecoq, c’est « une misérable savate ! (…) Lecoq n’a pour lui que son énergie » (traduction française de Pierre Baillargeon pour l’édition Robert Laffont de 1956). Malgré ce dédain envers ses aînés, Holmes a plus d’une dette envers les détectives qui l’ont précédé dans la profession :
- Les aventures de Sherlock Holmes sont racontées par son colocataire et ami, le docteur John Watson, qui l’accompagne dans ses enquêtes et lui sert de faire-valoir. Chez Edgar Poe déjà, le narrateur partage un appartement avec C. Auguste Dupin ; dans Le petit vieux des Batignolles de Gaboriau, le narrateur est un étudiant en médecine qui fait la connaissance du policier Méchinet et l’accompagne dans son enquête ; dans Maximilien Heller, le narrateur est également un médecin, ami du détective !
- Sherlock Holmes excelle dans l’art du déguisement — comme déjà Vidocq, et à sa suite M. Méchinet dans Le petit vieux des Batignolles, et Maximilien Heller !

- Le « canon holmésien » est constitué essentiellement de nouvelles (cinquante-six, pour être précis), et de seulement quatre romans. Pour ceux-ci (Une étude en rouge, La marque des quatre, La vallée de la peur et à l’exception du Chien des Baskerville), Conan Doyle a utilisé une structure en deux parties : le récit débute par une enquête, interrompue par un retour en arrière qui explique les causes du drame, et suivie d’une conclusion où réapparaît le détective. Il a donc utilisé la structure des romans judiciaires de Gaboriau !
Si Sherlock Holmes est universellement connu aujourd’hui, au détriment de ses prédécesseurs français et américains, ceux-ci survivent tout de même à travers leur glorieux successeur, qui leur doit beaucoup !
Jérôme Serme




